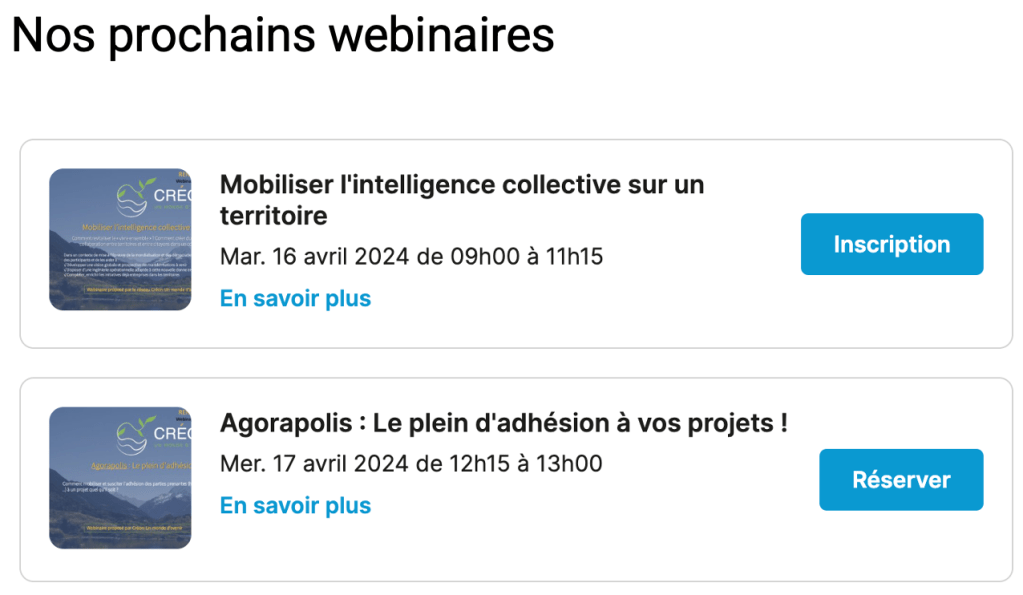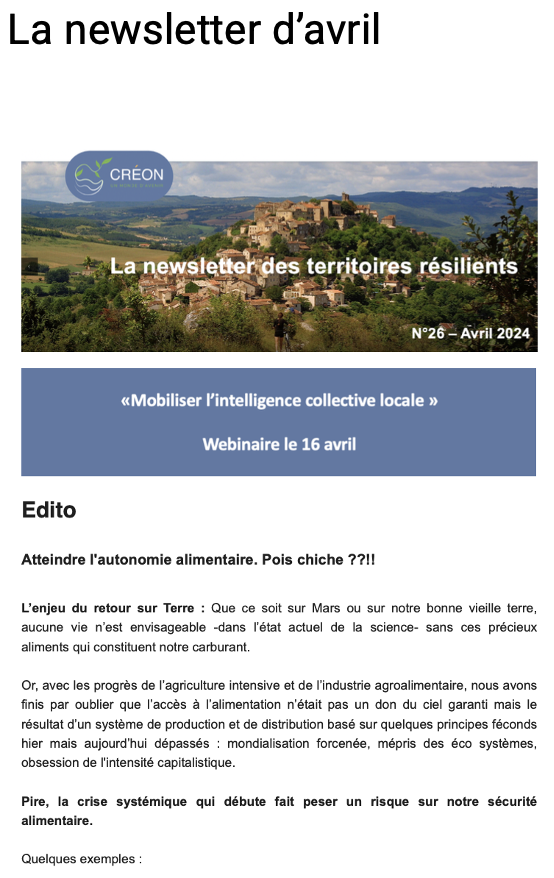Devant nous, la promesse d’un désordre systémique (climatique, géo politique, socio-économique et peut être sanitaire) sans précédent si nous ne nous ressaisissons pas rapidement en tant que citoyens et en tant que nation.
Et pourtant, face à cette menace qui se précise, l’actualité fourmille d’exemples de mal adaptations :
- Lutte contre le réchauffement climatique ? Un moratoire de plus sur l’interdiction des glyphosates en France et la mise à l’index du pacte vert européen en guise de réponse au désespoir économique et professionnel des agriculteurs européens
- Meilleure répartition des richesses ? Procrastination à tous les étages (Europe, France) face à la pression des lobbies (industriels, distributeurs, plateformes et réseaux sociaux) et défenseurs des hyper riches
- Valorisation du travail et lutte contre le chômage ? Généralisation de jobs (de plus en plus ubérisés) le plus souvent mal payés, peu protecteurs et sans perspectives
- Plan Marshall pour la réindustrialisation du pays et sa souveraineté économique ? Quelques licornes High techs et des jeux du cirque (les jeux olympiques) hors de prix (empreinte carbone, montant de l’investissement, prix des billets) mais donnant lieu à une exfiltration de ceux que l’on devrait aider (travailleurs pauvres, SDF, étudiants)
- Dégradation des services publics ? Une avalanche de novlangue pour magnifier l’hôpital, l’école public, l’intérêt général et « en même temps » l’austérité budgétaire et la poursuite des fermetures de lits, de classes,..
- Revitalisation démocratique et lutte contre l’abstention ? L’accumulation de dispositifs (cahier des doléances, grand débat, Convention citoyenne pour le climat, Ségur à répétition) hautement instrumentalisés et la multiplication des atteintes aux libertés individuelles et collectives (drones, caméras de vidéosurveillance, interdiction de manifester avec ou sans casseroles, arrestations préventives..)
Les ingrédients du cocktail qui nous attend sont déjà connus :
- Une fracture sociale abyssale avec le risque permanent d’implosion/explosion de ce qui reste du vivre ensemble
- L’accession au pouvoir d’un régime autoritaire et sectaire
- La multiplication des accidents climatiques et des tragédies humaines associées
- L’enfoncement dans la pauvreté et la précarité d’une partie croissante de la population
- La montée des tensions géo politiques et l’imposition d’une économie de guerre
Dans ce contexte de montée des périls, nous pourrions nous attendre à une mobilisation massive et pacifique des peuples pour la promotion d’une société plus « Care » (plus démocratique et respectueuse de la planète et de ceux qui l’habitent). Un refus de l’inacceptable : Projets écocides et incurie climatique, massacre des palestiniens, paupérisation des agriculteurs, épuisement des soignants, répression des mouvements écologistes, ..
Las ! La plupart des sapiens ne bronchent pas ou si peu et poursuivent leurs routines tant que leur intérêt particulier n’est pas directement inquiété.
Comment expliquer cette absence de réaction face à la montée des périls ?
Au cœur de tout : Une relation au temps devenu pathologique
Coursiers, cadres en entreprise, mères isolées avec enfant à charge, étudiants bossant chez Mac Do, nous sommes de plus en plus nombreux à courir après le temps, à accumuler/enchaîner les activités (vie professionnelle, démarches administratives du quotidien, contraintes familiales). Pour ceux dont les emplois du temps sont les plus chargés, les quelques moments de temps libre sont consacrés à la réparation (dormir, se reposer) ou au délassement (se changer les idées, oublier la machine).
Si certains sont effectivement épuisés, fracassés par le système économique, d’autres sont en revanche responsables de cet empilement d’activités : Cadres et dirigeants d’entreprise enchaînant les réunions inutiles, adorateurs de Netflix et de jeux vidéo, ..
Ainsi, librement ou par obligation, nous sommes dans le guidon et tentons de nous dégager du peloton quitte à donner des coudes à nos co citoyens considérés comme concurrents.
Nous voici devenus hamsters compulsifs asservis à une roue du temps qui semble de plus en plus nous échapper.
Tant d’énergie gaspillée à détruire la planète.
Pire, certaines de nos activités et de nos inclinations nuisent à la planète : tourisme, mode, alimentation,..
Si « On ne tombe pas amoureux d’un taux de croissance », ayons enfin le courage d’interroger ce culte de la croissance à 2 chiffres et de l’hyper consommation. Ai-je absolument besoin de ce smart phone de dernière génération ou de ce tailleur Zara ?
Saccager la planète et mettre au travail l’humanité jusqu’à 64, 65 ou 66 ans ? Dans quel but ? Pour quel projet de société ? Pour quel projet de vie en commun ? Au bénéfice de qui ?
L’hyper consommation et l’hyper activité nous rend elle heureux ?
« L’américain moyen dépense soixante fois plus d’énergie que le chasseur-cueilleur moyen de l’âge de pierre. Est-il pour autant soixante fois plus heureux ? » Yuval Noah Harari
Nous savons que non. Alors pourquoi ne pas ralentir ?
Le monde ira mieux le jour où nous exigerons des voitures légères et sous équipées ; le jour où nous refuserons de nous endetter pour consommer toujours plus. Le jour où nous revendiquerons l’oisiveté.
Arrêtons de nous épuiser à perpétrer des activités et des rythmes de vie qui nous empêchent de réaliser la situation périlleuse dans laquelle se trouve notre espèce et donc d’agir.
Il est urgent de prendre du recul par rapport aux évènements qui s’accélèrent et se bousculent. Il nous revient de comprendre la marche du monde pour reprendre le contrôle de nos existences.
À la recherche de tout ce temps perdu ….
Pour ceux qui le peuvent économiquement, réapprenons l’oisiveté et savourons la lenteur propice à la réflexion et à la méditation.
Pour tous, il s’agit de miser sur la sobriété et la sélectivité (« qui trop étreint mal embrasse »)
Réapprendre l’empathie et se rendre disponible à l’autre (ses combats, ses difficultés, ses aspirations) et à soi-même (notre être, nos aspirations, nos rêves).
Prendre le temps de la réflexion, c’est la possibilité de passer de :
- L’amnésie et l’aveuglement provoqués par les réseaux sociaux et les chaînes d’info en continue à la pleine conscience des évènements qui comptent vraiment
- L’insensibilité généralisée à la compassion et à l’empathie pour les fracassés
- La consommation compulsive et écocide à la consommation sélective et responsable
Comment ralentir ? Comment retrouver ce temps perdu ?
Objectif « Dégager de mon temps »
Tout commence par mettre de l’ordre dans ses pratiques (consommations, engagements associatifs, agenda professionnel) afin de sanctuariser ne serait ce que trente minutes quotidiennes.
Il s’agit de mettre à profit un peu de ce temps pour :
- S’enquérir de la marche du monde, lire autre chose que l’Équipe ou Femme actuelle, s’intéresser à l’histoire, à la géo politique, à l’économie.. S’instruire.
- Participer à des réunions, à des débats, conférences
- Même si cela n’est pas sans risques, parler politique avec ses proches et ses amis
- Prendre le temps d’écouter les alertes des scientifiques (climatologues, sociologues) et des associations humanitaires et d’écouter enfin sa conscience (suis-je satisfait de cette vie de hamster ?)
Objectif « Ralentir »
- Se consacrer intensément à une seule activité à la fois (manger, visiter un monument, discuter avec son interlocuteur OU regarder son smart phone)
- Ne pas vouloir tout faire vite mais privilégier la lenteur et la contemplation (découvrir Paris en 3 jours, Non, non et non !).
- Savourons intensément chaque instant de chaque activité. Apprenons à aimer les objets, à les faire durer et la planète s’en portera mieux (et notre porte-monnaie aussi)
La vie de hamster est compulsive ; à l’instar d’une drogue à accoutumance, il nous faudra du courage pour lâcher la roue. Et pourtant, nous devons ralentir et vite !
Good night and good luck

Compte tenu des évolutions à venir, le profil de l’élu local est appelé à évoluer rapidement et fondamentalement. Exit les grands architectes les bras chargés de promesses et de projets. Bienvenu aux élus visionnaires et catalyseurs d’énergies !
Le constat : En l’absence même d’un big collapse précipité par une nouvelle pandémie, un krach financier ou un conflit international (en mer de chine, au proche orient ou en Europe), on peut pronostiquer que les prochaines années se traduiront par :
- Une augmentation des conflits sociaux sur des sujets variés : Lutte contre le dérèglement climatique, les injustices, l’atteinte aux libertés, la défense des minorités, etc
- Une augmentation de la pauvreté et de la précarité : Étudiants, agriculteurs, gilets pauvres, ..
- Un durcissement démocratique et un régime de plus en plus autoritaire et centralisateur
- Une dégradation des services publics et de la protection sociale ; un gouvernement ne pouvant pas « en même temps » défendre les « super profits », augmenter les budgets militaires et régaliens et simultanément investir massivement dans l’hôpital, l’éducation, le logement ; secourir les plus faibles et la planète
Bien sûr, cette promesse d’affaissement ne serait pas une fatalité si la priorité était donnée à une politique radicalement réorientée.
Malheureusement d’ici 2027, le programme qui s’annonce est bien peu réjouissant : Une surenchère de novlangue pour tenter de cacher une absence de vision stratégique.
Le port de l’uniforme à l’école ou la lutte implacable contre les « parasites » (chômeurs, émigrés, insoumis, écologistes, ..) ne réduiront pas l’empreinte carbone du pays, sa désindustrialisation, son déficit commercial, la détresse des agriculteurs, la paupérisation des services publics ou la montée du ressentiment envers les élites ….
Aussi, les élus locaux se retrouvent déjà en première ligne et seuls pour traiter de nombreux défis :
- Un défi financier :
- Faire plus et mieux avec moins
- Procéder à de déchirants arbitrages entre projets, entre dépenses
- Améliorer la productivité et l’agilité organisationnelle des services de la collectivité
- Trouver de nouvelles sources de financement
- Un défi social
- Retisser le lien social et booster le vivre ensemble
- Mobiliser l’intelligence collective
- Un défi stratégique : développer la résilience
- Relocaliser et gagner en autonomie (notamment énergétique et alimentaire)
- Développer la solidarité, l’entraide
- Faire le choix d’une croissance sélective
- Un défi écologique :
- Prévenir le risque d’accident climatique et adapter les comportements en conséquence
- Réussir la transition écologique en accompagnant les secteurs les plus impactés : Agriculture, transports, industrie, BTP, ..
- Réduire l’empreinte carbone du territoire (en misant notamment sur la sobriété)
Cela fait beaucoup sur les épaules d’édiles locaux non préparés à affronter de telles complexités. La plupart n’ont pas signé pour endosser la mission d’Hercule.
Cette grande difficulté à faire face à ces défis explique en partie le découragement de certains d’entre eux et la montée de l’abstention de la part du corps électoral ; témoin de cette impuissance.
Près de 4 000 élus démissionnaires depuis le début du mandat en 2020 selon le président de l’AMF. Avril 2023
Et pourtant, beaucoup pourrait être fait pour construire un monde porteur d’avenir à l’échelle locale si les élus locaux décidaient de changer de posture et d’habitudes.
Attachons-nous donc à décrire le portrait de l’élu porteur d’avenir.
Les qualités porteuses
- Une vision stratégique cohérente des défis à relever et d’un développement porteur d’avenir.
Nombre de nos concitoyens sont désorientés et angoissés face à l’accumulation de ce qu’ils considèrent comme des menaces (climat, paupérisation, émigration, .. ). Certains sombrent dans la phobie ou la violence ; d’autres dans le repli sur soi et l’abstention. Le premier courant politique ayant pour nom « Ressentiment ».
Seule une vision, une grille de lecture transcendante -à la fois porteuse de sens et désirable aux yeux des citoyens- permettrait de sublimer ces pulsions mortifères et de stopper cette tectonique des foules. La quête de résilience locale pourrait incarner cette boussole, cette trajectoire porteuse de sens qui permettrait de fédérer positivement les énergies. Rappelons que la résilience s’appuie sur 4 priorités absolues : la solidarité et l’entraide, la sobriété, l’autonomie, la préservation et le développement du bien-être. Qui ne signerait pas pour un tel programme ?!
- L’incarnation d’un esprit d’équipe, d’un collectif.
Comment faire maison commune avec tous ceux qui n’ont pas voté pour moi (opposants ou abstentionnistes) devrait être le leitmotiv dès le lendemain des élections et tout au long du mandat. Être élu avec 60 % de la moitié du corps électoral (sans compter tous ceux qui n’ont pas le droit de vote) n’est absolument pas satisfaisant. Il s’agit d’aller à l’écoute des opposants et des silencieux, de dépasser les postures de principe et de réconcilier les points de vue autour de débats authentiquement démocratiques. Les outils et méthodes existent en la matière.
Dans le même ordre d’idée, l’élu porteur d’avenir s’appuiera sur un management extrêmement participatif, synonyme d’écoute, de délégation et de confiance réciproque. Par exemple, les élus devraient ouvrir leur agenda à leurs collaborateurs les plus proches et leur permettre de décider de leur participation à différentes réunions. L’exemple peut paraître trivial et pourtant il symbolise à merveille cet esprit d’équipe et de confiance.
- Un élu courageux qui parle vrai et responsabilise.
On le sait déjà, les prochaines années seront extrêmement compliquées dans un contexte environnemental terriblement instable. Les Français dans leur ensemble sont suffisamment adultes pour entendre la vérité la plus crue. Rappelons-nous du discours de Winston Churchill prononcé le 13 mai 1940 devant la chambre des communes. On se souvient de » Je n’ai rien d’autre à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur » mais on aurait tort d’oublié l’espoir qu’il pointe au bout de son discours : « Vous me demandez quel est notre but. Je vous réponds en deux mots : la victoire, la victoire à tout prix, la victoire malgré toutes les terreurs, la victoire quelque longue et dure que puisse être la route : car, hors la victoire, il n’est point de survie ». Il suffirait aux élus de remplacer « victoire » par « vivre ensemble dans la solidarité, la sobriété et l’autonomie » pour libérer des trésors d’énergie et de résilience.
Les habitants peuvent accepter que leur élu ne puisse pas tout. Par contre, celui-ci doit s’engager sur l’essentiel ; à savoir préserver la cohésion sociale fondée sur des valeurs trop souvent galvaudées : Liberté, égalité, fraternité
- Une posture de coach qui libère les énergies et booste l’intelligence collective
Une posture de coach de territoire
Fondamentalement, il s’agit pour l’élu de mettre en capabilité les habitants et les acteurs locaux. Ne plus leur dire, « j’y réfléchis, j’ai la réponse/je m’en occupe » mais « que proposez-vous ?» ou « J’en suis certain, vous trouverez la réponse »
Voici plus en détail la concrétisation en actes de cette posture :
- Stimuler les initiatives, responsabiliser les habitants
- Fournir les ressources, « armer » les acteurs locaux
- Garantir le respect de règles du jeu démocratiques. L’élu coach s’interdit de programmer l’avenir de son territoire ; synonyme d’asphyxie de l’intelligence collective. Sa priorité est au contraire d’apporter de l’oxygène au tissu local et de libérer les initiatives. Il s’attache donc à mettre en place l’ingénierie nécessaire à cette démocratisation de la décision locale. Dans ce sens, il n’oublie pas de garantir le respect d’un certain nombre de règles démocratiques au sein des débats : écoute active, objectivité, argumentation, concession, …
- Valoriser – mettre en avant les initiatives des habitants et des acteurs locaux
- Incarner et promouvoir des valeurs, des principes d’action qui mobilisent et fédèrent. L’élu coach est conscient du risque de cacophonie décisionnelle et de forces centrifuges. Aussi prend il le soin d’exprimer et de faire respecter quelques règles de jeu (transparence, concertation), de priorités (intérêt général) et de repères (la boussole de la résilience) permettant de garantir cohérence et cohésion
Sa stratégie – son agenda
L’emploi du temps d’un individu nous apprend beaucoup sur la réalité de ses priorités. Alors, quel devrait être le quotidien de l’élu local ?
- Communiquer une vision stratégique et des valeurs porteuses d’avenir en s’appuyant sur une communication virale portée par les acteurs locaux (notamment le tissu associatif). L’enjeu est de susciter une participation massive des habitants au(x) projet(s) du territoire. Inaugurations, vœux, réunions publiques, conseils municipaux, … sont autant d’occasion pour l’élu de communiquer sa vision (la résilience en tant que boussole et trajectoire porteuse de sens) et sa détermination à la réaliser quelque soit les obstacles. Convaincre, toujours convaincre, stimuler, inciter à l’engagement.
- Mettre en place et faire vivre une gouvernance partagée du territoire
- Constituer et développer sa dream team, l’écosystème local. Lui revient d’entretenir et développer l’esprit d’équipe au sein de son administration et de son conseil municipal. De même, il doit s’assurer que les entreprises locales ne se contentent pas de cohabiter comme c’est souvent le cas mais qu’elles mutualisent, partagent leurs ressources (informatique, R&D, ..) et leurs actions
- Associer massivement la population aux projets et décisions locales les plus critiques
- S’assurer du déploiement d’outils de démocratie locale : référendum, convention citoyenne, RIC local, civic tech.
- En résumé, déléguer, déléguer et encore déléguer
- Faciliter et promouvoir/diffuser les initiatives des acteurs locaux et des habitants
Les pièges à éviter
Tel Ulysse, l’élu doit apprendre à résister aux charmes des sirènes. Autant de pièges et de combats qui le détourne de sa quête de résultats. Voici les tentations les plus piégeantes :
- Défendre/Porter un programme détaillé d’engagements et de projets et cela pour au moins 2 raisons :
- Crise financière de 2008, Pandémie de 2020-2021, guerre en Ukraine, …. Nous entrons dans une période de plus en plus instable et incertaine et cela sur tous les plans. Les territoires doivent se faire roseau ; c’est-à-dire agiles et résilients. Aussi, les élus doivent arrêter de s’engager sur des programmes suspendus au bon vouloir de l’environnement. Beaucoup peut être fait en matière de souveraineté, de sobriété, d’entraide et de développement économique sans grands programmes structurants
- Les décisions technocratiques et qui tombent d’en haut sont de plus en plus mal accepté par les Français qui souhaitent être associés aux décisions qui les concernent. Il suffit de noter la montée des conflictualités et des recours autour des projets
- Être omni présent ; incarner l’homme-orchestre de tous les combats et de toutes les décisions. Souvent animés de bonnes intentions, nombre d’élus locaux cumulent trop de fonctions ou mandats : Président d’EPL, d’OPH, d’associations, membres de conseils d’administrations, … Si « trop embrasse, mal étreint », les élus devraient laisser davantage de places aux autres acteurs locaux pour se concentrer leur énergie et agenda sur les 3 priorités évoquées précédemment
- Se faire pompier ou père noël. Un mandat local est chronophage, voire épuisant pour l’élu qui ne sait pas dire « non ». Dès le début de son mandat, celui-ci doit mettre en place le système de délégation lui permettant de ne pas être de permanence 24h sur 24.
- S’en remettre à la générosité des autres (l’État, la région ou la communauté européenne). Nous rencontrons souvent des élus qui se plaignent. «Si seulement, on nous donnait de l’argent, ce n’est pas les projets qui manquent ». Oui mais voilà, il ne pleuvra pas de roubles dans les prochaines années et il existe d’autres moyens à investiguer pour financer le développement local : Financement participatif, monnaies locales, mécénats,.. « Aide toi et le ciel t’aidera » constitue un mantra d’avenir
- Représenter un camp, privilégier l’intérêt d’une partie de la population. Dès sa désignation, l’élu local doit élargir sa base d’alliés et de soutiens quitte à justifier le renoncement à certaines promesses trop partisanes. Raison de plus d’ailleurs pour ne pas s’engager sur un programme trop détaillé.
Le découragement gagne de plus en plus élus locaux et le phénomène risque de se généraliser tant les menaces s’accumulent faute d’être traitées à l’échelle européenne et/ou nationale.
Une seule solution face à cette montée de la complexité et des pressions : Changer de posture et développer de nouvelles compétences.
Place à l’élu visionnaire et catalyseur d’énergie !
Lire « Recréer du lien social, de la convivialité de proximité«
Good night and good luck

… Quel avenir pour le tourisme ?
Dans les prochaines années, le tourisme est appelé à évoluer radicalement pour des motifs écologiques mais aussi socio-culturels. Comment anticiper et accompagner ces transformations ?
Définition OCDE : « Le tourisme peut être considéré comme un phénomène social, culturel et économique lié à la circulation des personnes en dehors de leur lieu de résidence habituel ».
Dans le monde :
- 969 millions de touristes transfrontaliers en 2022 soit 12 % de la population mondiale
- 10 % du PIB mondial
- 10% des emplois sur la planète
En France :
- Depuis les années 1990, la France est la première destination touristique au monde (90 millions d’arrivées de touristes internationaux en 2019)
- En France, en 2019, le tourisme a généré 1,7 million d’emplois, soit 7,3 % de l’emploi total.
Et pourtant, l’été dernier 6 Français sur 10 n’étaient pas partis au cours des cinq dernières années. Enquête menée par l’Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT) et la Fondation Jean-Jaurès
Voyager ! Mais pourquoi ?
Le voyage récréatif (on ne parle pas ici d’émigration contrainte) n’est pas une pratique récente. De tout temps, nombre des sapiens qui pouvaient se le permettre en ont profité.
Il s’agissait alors de satisfaire un désir de dépaysement, d’aventures et d’émotions.
Depuis, le tourisme s’est développé pour devenir un phénomène de masse.
Joffre Dumazedier, sociologue du loisir de référence identifiait 3 besoins associés aux activités de loisirs :
- Se Délasser : Se reposer, reprendre des forces, récupérer
- Se Divertir : S’amuser, se distraire, jouer
- Se Développer : Apprendre, découvrir de nouvelles cultures
Si l’on se réfère à cette théorie des 3 D, seul le besoin de développement pourrait justifier de dépenser tant d’énergie et d’argent pour traverser les océans et les continents.
Or de nos jours, la réalité du tourisme de masse se limite souvent à :
- Une accumulation de clichés : Qui n’a pas assisté à ces scènes de touristes agglutinés devant un monument, un paysage grandiose le temps d’un selfie ou d’une photo de groupes pour… dans la minute qui suit remonter dans leur bus ou SUV de location…. Le Taj Mahal, la pyramide de Gizeh, la Sagrada familia, le Grand canyon, la tour Eiffel, … Aux yeux de ces touristes, rien ne semble assez beau pour justifier quelques minutes de contemplation.
- Des séjours chronométrés : Le temps moyen de séjour à Venise est inférieur à une journée. Et que dire de ces circuits découverte de 15 jours à travers les États unis, ces weekends all included à Paris, Londres, New York ??
- Un entre soi : Bateaux croisières, villages vacances, pistes de skis, de danse. De nombreux voyages à l’étranger se résument à un entre touristes
- Des voyages normés : Aujourd’hui, les destinations doivent impérativement s’aménager selon les standards du tourisme international. Tout y passe ou presque : gastronomie, commerces, hôtels, plages, …
- Des rythmes routiniers et des comportements moutonniers : Plage à 11h, déjeuner familial à 14h, retour à la plage pour 15h30, le meublé ou l’hôtel pour 18h, restaurant pour touristes à 19h, déambulation sur le bord de mer vers 21h… et ainsi de suite jusqu’à la fin du séjour. Mykonos, Venise, Dubrovnik vues du ciel ?? Deux ou trois rues commerçantes bondées de touristes en transhumance et tout autour des rues désertes. Obliquer dans les ruelles transversales ?? Quelle aventure !!
Mais alors Pourquoi partir à l’étranger si c’est pour reproduire les mêmes comportements, les mêmes routines !! ?? A quoi bon s’évader si c’est pour revenir plus pauvre (ou moins riche) et inchangé ?
Quelle proportion de touristes s’aventurent en dehors des sentiers battus ?
Tourisme. Un secteur appelé à se transformer radicalement de toute façon
Au regard de l’analyse qui précède, certains répondront que nous sommes en économie de marché et que si le tourisme industriel séduit les masses, c’est tant mieux. Laissons faire Airbnb, MSC et consorts.
Malheureusement (ou heureusement), le tourisme de masse n’est plus supportable en l’état pour plusieurs raisons :
- Écologiques et climatiques : Empreinte carbone représentée par les transports et les aménagements dédiés au tourisme, artificialisation d’espaces fragiles, tension sur les ressources hydriques, foncières, pollution, neige artificielle déversée sur les pistes de ski, ..
- Urbanistiques : Dénaturation de paysages, villes bétonnées, stations fantômes hors saison, ..
- Économiques et sociales : Augmentation des prix (et pas que de l’immobilier) et expropriation des habitants à l’année, … disparition des commerces de proximité (boucheries, épiceries, ..), dépendance outrancière à la manne touristique qui rend vulnérable la destination en cas de pandémie, de conflits ou d’attentats
Enfin, de plus en plus de locaux ne supportent plus cette forme de colonisation économique et culturelle. La résistance s’organise en Croatie, en Bretagne, à Venise, Athènes, Barcelone, ..
Quel tourisme pour demain ?
Rapidement, le tourisme doit se faire plus responsable et résilient.
- Responsable vis-à-vis de la planète et des locaux
- Résilient quel que soit les circonstances (fermeture des frontières, crise économique ou sanitaire, …)
Les caractéristiques d’un tourisme plus vertueux :
- Un tourisme de proximité. La nécessité de réduire notre empreinte carbone et l’augmentation tendancielle des coûts de l’énergie nous imposent de nous tourner davantage vers un tourisme de proximité.
- Un tourisme d’intention, de projet. Pour se protéger de la sur fréquentation, des communes commencent à fixer des quotas de visiteurs (les Calanques), des interdictions de stationner pour les piétons (Portofino), voire appliquent des droits d’accès à leur cœur de ville. Visiter les sites les plus recherchés deviendra l’aboutissement d’un désir réfléchi, préparé, anticipé.
- Un tourisme du temps lent (slow tourism). Apprendre à savourer plutôt qu’accumuler les clichés. Prendre le temps de sortir des itinéraires et programmes prés formatés. Privilégier l’intensité et la sélectivité.
- Un tourisme d’immersion. Séjourner chez l’habitant. Vivre au milieu et avec les locaux et refuser l’enfermement des ghettos à touristes. Ne pas venir pour faire le plein de pacotilles et de sacs Hermès mais pour revenir la tête pleine de souvenirs de nouvelles rencontres.
- Un tourisme de la réciprocité. Échanges d’appartements, participation à l’organisation d’un évènement local, contribution à un chantier de restauration, à des travaux agricoles, ..
- Tourisme d’itinérance : En janvier à Turin, en février à Munich, en mars à Innsbruck, … Avec le développement du télétravail, il devient possible d’envisager un tourisme nomade nécessairement moins carboné
Vision utopique ? Élitisme ?? Qu’importe. Le tourisme doit se réinventer et les pistes de transition ne manquent pas.
Le développement de ce tourisme plus vertueux suppose néanmoins que 2 conditions soient réunies :
- Un changement de nos comportements individuels. Il revient à chacun d’entre nous -en tant que voyageurs- de faire évoluer nos pratiques touristiques. S’interroger sur la nécessité de bruler tant de kérosène pour farnienter 15 jours sur une plage que ce soit à Punta cana, Pattaya ou Acapulco ; de traverser l’atlantique pour passer 4 heures à Machu Picchu, 6 à La Paz et 3 à Cuzco.
- Une adaptation de l’offre touristique locale. La bonne volonté individuelle ne suffira pas. Il s’agit pour les collectivités locales et les acteurs du secteur de réinventer leur offre avec une priorité : développer un tourisme du lien (immatériel) moins coûteux et plus enrichissant qu’un tourisme du bien (matériel).
La Joconde ne racole pas, elle rayonne. La vraie beauté n’est-elle pas intérieure ? Plutôt que de chercher à attirer le regard des voyagistes et des touristes à coups d’infrastructures et de campagnes publicitaires, la priorité des collectivités devrait être de répondre aux besoins non satisfaits de leurs habitants. Ce n’est pas à Barcelone, Pétra ou Avoriaz de s’adapter aux exigences du tourisme international mais aux visiteurs de s’adapter à la vie locale fusse-t-elle plus rustique. Visiter Rocamadour ou Bonifacio devrait se mériter. Ainsi, le tourisme ne devrait pas être considéré comme un axe de développement mais comme un bonus récompensant une qualité de vie plébiscitée par l’ensemble des habitants.
En conclusion. Beaucoup de changement en perspectives. Autant d’évolutions qui devront être le résultat d’un processus profondément démocratique.
Good night and good luck

Entre réforme des retraites et interdiction des trottinettes en libre-service à Paris…
D’un côté une réforme des retraites qui va lourdement impacter l’existence de la majorité de la population mais qui lui est pourtant imposée.
De l’autre un référendum local qui invite les Parisiens à se prononcer sur un sujet mineur.
Faut-il s’étonner de la montée de l’abstentionnisme ?
Notre démocratie ne mérite-t-elle pas mieux ?
Les faits : Le 2 avril, la mairie de Paris a organisé une consultation « Pour ou contre les trottinettes en libre-service » (*)
(*) En octobre 2022, 400 000 utilisateurs uniques avaient utilisé une trottinette en libre-service, soit une hausse de 71 % en deux ans.
Organisation de la consultation :
- 203 bureaux de vote (ouverts de 9h à 19h)
- 1 270 agents mobilisés toute la journée
- + budget de communication
Bilan de l’opération :
- Sur 1,3 millions d’électeurs inscrits, moins de 8 % % de votants (soit un taux d’abstention de 92 %)
- Près de 90 % des votants (personnes âgées et a priori peu utilisatrices) se sont prononcés contre l’autorisation des trottinettes en libre-service
- Au total, une minorité d’électeurs prive la capitale d’un moyen de transport pratique et plutôt doux
A quand un référendum sur la fermeture des bars pendant l’heure de la sieste ou l’interdiction pour les jeunes des banlieues d’entrer dans les métropoles ?
Comprenons-nous. Notre propos n’est pas de nier les nuisances provoquées par ce type de services mais de pointer les effets contre productifs de consultations mal pensées.
En 2022, les trottinettes dans leur ensemble ont occasionné 3 morts à Paris. A titre de comparaison, rappelons qu’avec plus de 2 500 décès prématurés par an, la capitale française est la 4e ville d’Europe pour le nombre de victimes du dioxyde d’azote, selon une étude de « The Lancet Planetary Health ».
Mise en perspective du besoin de démocratie participative :
- Le monde est confronté à une crise transformation systémique (dérèglement climatique, récession économique structurelle, montée des tensions géo politiques, fracturation sociale, ..)
- Face à la montée des périls, seules l’intelligence collective et la solidarité nous apporteront l’indispensable résilience
- Pour les mêmes motifs, il est urgent de faire appel à l’esprit de responsabilité et à l’intelligence situationnelle plutôt qu’à l’accumulation d’interdits et de réglementations qui pèsent de plus en plus sur les libertés individuelles
- Dans leur immense majorité, les Français sont responsables et raisonnables à la ville comme aux champs. Alors pourquoi toujours leur faire payer le comportement d’une minorité ? Une démocratie adulte miserait sur l’esprit de responsabilité ; quitte à sanctionner les quelques irresponsables.
OUI, les élus locaux ont raison de vouloir associer leurs habitants à la gouvernance de la cité sachant que de plus en plus de français le souhaitent et qu’à l’échelle nationale, notre démocratie frôle l’asphyxie.
Encore faut-il respecter quelques conditions de réussite.
- Choisir un thème/sujet/question suffisamment vital pour susciter la participation de l’ensemble des habitants (et non pas uniquement les aînés et les CSP +)
- Fixer un taux de participation de l’ensemble des catégories de population en deçà duquel, la consultation est considérée comme non conclusive
- Avant la consultation organiser :
- Une communication virale qui (re)mobilise les abstentionnistes
- Des débats publics permettant aux différents points de vue de s’exprimer et de rechercher des solutions constructives qui privilégient le vivre ensemble
- Offrir la possibilité de vote électronique et de vote par procuration
En conclusion, face à la montée des colères et des conflictualités, les territoires de proximité risquent de se transformer en champs de bataille si les élus locaux ne prennent pas l’initiative d’un dialogue démocratique renouvelé.
Les consultations citoyennes contribuent à cette indispensable respiration démocratique locale mais elles doivent s’inscrire dans une stratégie d’ensemble qui privilégie un dialogue éclairé, constructif et permanent entre toutes les composantes de la population.

L’enjeu du retour sur Terre : Que ce soit sur Mars ou sur notre bonne vieille terre, aucune vie n’est envisageable -dans l’état actuel de la science- sans ces précieux aliments qui constituent notre carburant.
Or, avec les progrès de l’agriculture intensive et de l’industrie agroalimentaire, nous avons finis par oublier que l’accès à l’alimentation n’était pas un don du ciel garanti mais le résultat d’un système de production et de distribution basé sur quelques principes féconds hier mais aujourd’hui dépassés :
- La mondialisation des échanges : Le Canada nous achète nos vins et nous importons ses semences et fruits. Ne sommes-nous pas capables de produire suffisamment de fruits ou de semences ? Ne serait-il pas plus raisonnable de manger du mouton français plutôt que de l’importer ? Le bon sens nous inciterait pourtant à le faire.
- La libre concurrence et circulation des marchandises ; en Europe la souveraineté alimentaire n’étant jusqu’à présent pas considérée comme relevant de l’intérêt général, certains biens alimentaires se vendent à prix coutant alors que de plus en plus de nos concitoyens ne mangent pas à leur faim. Si produire du maïs à profusion est rentable pourquoi me préoccuper de produire pour nourrir les Français ?! Business is business après tout.
- L’obsession de l’intensité capitalistique qui pousse à la concentration et à la déshumanisation (sans parler du mal être animal) des exploitations
Selon le dernier baromètre réalisé par l’institut Ipsos pour le Secours populaire, 32 % des Français ne sont pas en capacité de se procurer une alimentation saine en quantité suffisante pour manger trois repas par jour, et 15% déclarent même ne plus pouvoir assurer régulièrement petit-déjeuner, déjeuner et dîner, faute de moyens.
Pire, la crise systémique qui débute fait peser un risque sur notre sécurité alimentaire.
Quelques exemples :
- Les vagues de sécheresse, la salinisation des deltas de fleuves, la multiplication des accidents météorologiques réduisent les capacités de production
- La dégradation des terres et des éco systèmes due à un usage intensif de produits phytosanitaires
- Les conflits commerciaux voire armés entre pays (Houthis qui amènent les cargos à se dérouter, impact de la guerre en Ukraine sur le cours des céréales et de l’énergie, ..) qui perturbent les filières d’approvisionnement
Résultat. Le cours mondial des produits agricoles devrait connaître dans les prochaines années augmentation tendancielle et instabilité.
L’autonomie alimentaire redevient donc un enjeu de souveraineté.
Mais de quelle souveraineté alimentaire parle-t-on ?
Compte tenu de son potentiel agricole, la France devrait pouvoir garantir l’accès universel à une alimentation saine, suffisante, équilibrée et peu carbonée.
- Universelle : L’accès de tous sans exception à une alimentation est un droit universel trop souvent piétiné (et pas qu’à Gaza)
- Saine : Stop à la mal bouffe
- Suffisante : On considère comme minimum 1 600 calories par jour pour une femme adulte (et 2 200 pour un homme)
- Équilibrée : Un repas équilibré est le reflet d’un régime qui couvre les trois principaux groupes d’aliments que sont un quart de protéines, un quart de glucides et une moitié de légumes
- Peu carbonée : il s’agit de privilégier une production peu consommatrice de produits phytosanitaires et d’engins motorisés ; une production et une transformation de proximité
Certains organismes officiels, comme l’AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments), ont établi des recommandations sous forme d’apports nutritionnels conseillés (ANC) pour chaque type de nutriment, pour une journée complète. Ces ANC sont calculés sur la base des besoins nutritionnels moyens d‘un groupe d’individus représentatifs de la population.
Quelle stratégie alimentaire déployer à l’échelle locale ?
Sachant que d’ici 2027, il ne faut pas espérer un plan Marshall de l’alimentation (à moins d’un coup de théâtre peu probable), les collectivités locales doivent – à l’échelle de leurs bassins agricoles- agir vite et vraiment en adoptant une approche systémique ; c’est-à-dire en intégrant l’ensemble de la chaîne : la production, la transformation, la distribution et la consommation
Aujourd’hui, les démarches engagées de types PAT piétinent faute le plus souvent d’une réelle volonté politique mais aussi d’un manque flagrant d’ingénierie.
Quelques propositions d’ordre méthodologiques
Toute ambition d’autonomie alimentaire locale devrait se structurer autour des 4 piliers de la résilience :
- Sobriété : Une agriculture peu carbonée qui privilégie le travail humain et celui des écosystèmes
- Autonomie : Une agriculture orientée sur les besoins alimentaires de la population locale
- Solidarité : Une agriculture dont la production est accessible à tous (Sécurité sociale de l’alimentation ?)
- Intérêt général : Une agriculture qui privilégie la production d’aliments essentiels à une alimentation saine
Les objectifs/indicateurs de réussite d’une démarche de résilience alimentaire :
- % de la consommation alimentaire importée (à plus de 100 kilomètres)
- % de la production locale en bio
- % de la population en précarité alimentaire
- % de la population en surpoids
Deux conditions de réussite président à la réussite d’un projet local d’autonomie alimentaire :
- Un changement de comportement des consommateurs (et donc des habitants) : Manger moins de viande, moins de sucre et plus de légumes et de fruits ; acheter des produits locaux et de saison, manger moins pour certains. Tous ces choix intimes ne pourront être obtenus par la force réglementaire et/ou la culpabilisation (espérons-le !). Il s’agit donc de mobiliser l’ensemble des habitants et de faire appel à l’intelligence collective dans tout projet de transition alimentaire
- Une transition concertée des pratiques des professionnels (agriculteurs, transformateurs, distributeurs). Pour les agriculteurs, réorienter leur production est synonyme de risque économique et d’investissement souvent conséquent. Il est donc essentiel de les aider à prendre le virage d’une agriculture plus résiliente : prix garantis, commandes groupées, circuits courts sécurisés, distributeurs privilégiant les produits locaux, …
Au départ de la démarche, l’ensemble des parties prenantes (agriculteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs) doivent s’accorder sur quelques principes directeurs :
- Privilégier une agriculture locale et diversifiée
- Ne pas aller contre la nature : Produire, cultiver ce qui sera adapté aux conditions climatiques des prochaines années
- Encourager une agriculture saine et peu carbonée
- Se concentrer sur les cultures les plus nourricières
En conclusion : La recherche d’autonomie alimentaire à l’échelle nationale et locale redevient prioritaire en ce début de crise systémique.
Pour concrétiser cette ambition, les collectivités locales vont devoir s’appuyer sur une ingénierie leur permettant à la fois :
- Une mobilisation massive des habitants (en tant que citoyens et consommateurs)
- Une prise de conscience partagée des priorités
- Une implication démocratique de l’ensemble des parties prenantes
- Une organisation projet rigoureuse
Good night and good luck
Les élus locaux animés du désir sincère d’associer leurs administrés à la décision locale se plaignent souvent de l’essoufflement des initiatives démocratiques qu’ils engagent. Ils ont factuellement raison.
Après quelques mois de participation à une instance de démocratie participative (codev, convention citoyenne, ..), les échanges ont tendance à s’étioler et l’absentéisme à augmenter.
Voici donc la checklist que nous recommandons pour booster et pérenniser les initiatives de démocratie locale :
- Privilégiez les rencontres physiques car elles sont plus impliquantes que les participations en visio
- Incitez les habitants à fêter la démocratie locale. « On n’attire pas les mouches avec du vinaigre ». Aussi, n’oubliez pas d’organiser régulièrement des évènements festifs pour célébrer les propositions et travaux de vos instances de démocratie participatives. Les habitants seront d’autant plus enclins à participer à des ateliers de travail qu’ils les associeront à des opportunités de rencontres conviviales et festives
- Décentralisez les réunions au plus près des participants (réunions de quartier, de résidence) et dans des lieux/espaces familiers et/ou synonymes de liberté d’expression (ex : tiers lieux, cafés, ..)
- Investissez vos instances démocratiques d’un vrai pouvoir et de missions à fort enjeux. Préférez les instances délibératives (mandatées pour proposer des solutions) aux instances consultatives (qui remontent des doléances ou des attentes). Ne sollicitez pas vos habitants sur des sujets mineurs à leurs yeux. S’il s’agit de discuter de la couleur des bancs publics, ils ne se déplaceront pas en masse. Par contre, s’il s’agit de décider de la place de la voiture dans l’espace urbain ou de hiérarchiser les projets d’aménagement de la collectivité, ils sauront se rendre disponibles
- Soignez la rigueur organisationnelle et l’efficacité. Les ordres du jour approximatifs et l’absence de régulation des échanges découragent les participants les plus exigeants. Chaque réunion d’un conseil citoyen doit se terminer par un relevé de décisions. Le choix de l’animateur des réunions est à ce titre capital
- Carburez à la passion. Évitez d’en appeler au devoir démocratique (le pensum du citoyen responsable) mais misez sur les passions/hobbies de vos habitants. Un passionné de permaculture ne comptera pas ses heures s’il rejoint un club thématique « alimentation ». D’où l’intérêt de segmenter et démultiplier les thèmes de travail des conseils citoyens en autant de clubs thématiques
- Renouveler, essaimer, parrainer. N’attendez pas l’effet d’usure pour convenir avec les premiers participants des conditions de renouvellement de leur mandat. Incitez-les à recruter d’autres habitants. Utilisez les médias locaux pour valoriser le travail des habitants impliqués
- Appuyez-vous sur l’actualité : Deux voisins se rencontrent. Que se disent-ils ? De quoi parlent ils (lorsqu’ils se parlent encore) ? Du beau temps et de l’actualité (covid, météo, ). Chaque réunion devrait débuter par une lecture croisée de l’actualité (climatique, géo politique, sociale,.. )
Nous espérons que ces recommandations vous seront utiles pour garantir le dynamisme de votre démocratie locale.
De toute évidence, les actions individuelles ne suffiront pas à relever les défis contemporains et à venir (ex : réduction de l’empreinte carbone d’un territoire, recherche d’autonomie énergétique). Il s’agit de mobiliser l’ensemble des énergies et intelligences du territoire et donc celles des entreprises locales.
D’importantes économies pourraient être ainsi réalisées si ces entreprises mutualisaient davantage certaines de leurs fonctions (informatique, comptabilité, ..) et si elles partageaient leur effort de R&D pour réduire leur empreinte carbone par exemple.
On peut distinguer deux principales formes de mutualisation :
Le réseau d’alliés
Principe : basé sur le principe de la cooptation, le réseau d’alliés réunit des personnes physiques et/ou morales qui choisissent de mettre en commun leurs ressources sur un thème donné (lutte contre le réchauffement climatique, organisation d’une foire commerciale, création d’une filière alimentaire locale, ..)
Parties prenantes : il peut s’agir d’une alliance composée d’EPL, d’industriels, d’indépendants, …
Étapes de mise en place :
- Cooptation des alliés fondateurs (la core team)
- Définition de la promesse de valeur et rédaction d’une charte d’engagement
- Définition business model (comment le réseau se finance)
- Définition de l’organisation et le cas échéant constitution d’une association ou d’un GIE
- Choix des outils (notamment de communication et de collaboration en ligne)
Risques :
- Réunionite et inefficacité
- Masturbation intellectuelle
- Militantisme sectaire
Le cluster
Principe : Souvent impulsé par la collectivité, le cluster local réunit tout ou partie des acteurs locaux incités à participer collectivement à l’effort de résilience. Dans ce cas, le pilotage et l’organisation revient de préférence à un tiers (cabinet conseil ou équivalent) sur la base d’objectifs programmatiques (mutualisation des fonctions supports, de la R&D, achats groupés, ..)
Parties prenantes potentielles : l’EPCI, les entreprises et associations locales, la préfecture, la CCI, l’agence d’urbanisme
Étapes de mise en place :
- Choix d’un consultant
- Cadrage et organisation du cluster (finalité et objectifs, composition du comité de gouvernance et du comité opérationnel, ressources mises à disposition, communication et reporting, règles du jeu, .)
- Séminaire de lancement/teambuilding) en présence de l’élu local et des membres désignés du cluster
- Cartographie des fonctions à mutualiser et des achats à grouper
- Élaboration programme et planning
- Organisation de la fertilisation croisée au sein du cluster
Risques :
- Positionnement de la collectivité inadapté (laissez faire ou au contraire interventionnisme)
- Résistances au changement (rejet et retrait) des acteurs locaux mobilisés
Modalité de cartographie des fonctions à mutualiser :
1° temps : il s’agit pour chaque entreprise sollicitées de positionner l’ensemble de ses fonctions (recrutement, achat, informatique, juridique, …) sur une matrice en évaluant :
Le niveau d’efficacité actuelle de la fonction sur la base la plus objective que possible (ex : aujourd’hui, le niveau d’efficacité de notre processus de recrutement est il élevé, moyen, faible ?
Le caractère stratégique de la fonction (ex : dans les prochaines années, quel sera l’importance de notre processus de recrutement : élevée, moyenne, faible ?)
Puis de décider du sort de chaque fonction/sous fonction support en s’appuyant sur un outil matriciel (voir schéma)
- Externalisation de la fonction (on achète de la prestation)
- Mutualisation (des équipements et/ou des effectifs) avec d’autres entreprises
- Développement (je conserve la fonction en interne et conforte son efficacité)
- Commercialisation (je détache et facture du personne à d’autres entreprises)
- Utilisation outil matriciel (fichier « fonctions support »)

2° temps : Au niveau du groupement et pour chaque fonction considérée, il s’agit d’opter pour l’une des modalités suivantes en s’appuyant sur les données communiquées par chaque entreprise :
- Utilisation d’un Référent interne (Sénior ou Manager) à l’échelle du groupement si la charge de travail est inférieure à 1 ETP et si ce professionnel est disponible et motivé pour cette mission
- Achat de prestation (commande groupée) si la charge de travail à l’échelle du groupement est inférieure à 1 ETP et si aucun Sénior ou Manager disponible et motivé dans le groupement
- Recrutement d’un Référent (groupement d’employeurs) si la charge de travail à l’échelle du groupement est supérieure à 1 ETP et si aucun Référent Sénior ou Manager, disponible et/ou motivé dans le groupement
Pour se constituer et se développer, ces clusters locaux (meute d’entreprises qui misent sur les complémentarités et les synergies) ont besoin d’un organisateur, d’un animateur. Les aménageurs pourraient exercer cette mission.

Été 2023. À moins de croire au « pas de chance » pour ces villes qui se sont embrasées ou à la sauvagerie innée de certaines catégories de la population, il devient urgent de comprendre ce qui se joue à travers la multiplication des conflictualités, violences et affrontements au sein de notre société.
Les faits. Que peut-on observer ?
L’été dernier dans la foulée de la mort de Nahel, une partie du pays s’est embrasée avec pour comptabilité :
- Des destructions de biens (commerce, mobilier urbain, véhicules, ..)
- Des pillages
- Des provocations et des agressions à l’endroit des représentants de l’État (policiers surtout)
Le phénomène n’est pas nouveau mais jusqu’à présent, il touchait essentiellement les quartiers sensibles et les grandes villes. Depuis l’été dernier, il concerne également les villes moyennes et les centres bourgs.
Lorsque l’on observe ces scènes de violences urbaines, se dégage une impression d’immersion dans un jeux vidéo dans lequel l’identité de l’adversaire est réduite à un certain nombre de points à gagner si l’on parvient à l’abattre. Une version violente de Pokémon en quelque sorte.
Pire, ces poussées de colère commencent à provoquer des réactions en chaîne :
- Une doctrine de maintien contestable : Nasses, charges motorisées, tirs massifs, arrestations arbitraires, …
- Le développement de groupuscules d’extrêmes droites
- Une radicalisation de l’opinion publique
A quand des milices citoyennes armées… ?
Nous assistons à une radicalisation de la société. De moins en moins de nuance et de plus en plus de haine.
Il est urgent de mettre fin à cette montée des violences et conflictualités !
Les causes. Pourquoi toute cette violence ?
Au-delà des violences urbaines, attachons-nous à identifier les causes récurrentes de cette montée de la violence et des radicalités. Elles sont au moins de 3 ordres :
- D’ordre personnel et psychologique ; lié au parcours de vie et au quotidien de chacun d’entre nous
- D’ordre sociétal ; lié à l’environnement économique et social dans lequel nous évoluons
- D’ordre politique et technologique ; lié à l’idéologie des élites économiques et politiques
Ce qui tient à mon existence, à ma personnalité
Une ambiance de fin du monde. Plus ou moins consciemment, de plus en plus d’habitants de ce pays ressentent angoisse et anxiété lorsqu’ils pensent à leur avenir et à celui de leurs proches. Éco anxiété (écologique et économique), perte de repères. Avec la conviction que demain sera pire qu’aujourd’hui. Cette peur de l’avenir peut occasionner des comportements de fuite ou de paralysie mais aussi de colère et de désobéissance musclée.
Un processus de ghettoïsation. Un nombre croissant de familles se retrouvent coincées dans des quartiers de relégation. Des familles qui concentrent et cultivent pour certaines (victimisation) les difficultés objectives : stigmatisation, discrimination (à l’école, à l’embauche, contrôles au faciès), pauvreté et précarité. À l’opposé, se développent des quartiers bunkers peuplés de privilégiés (à Meudon ou Cannes, peu de jeunes en rébellion). Dans les 2 cas, une faible mixité. La France ressemble de plus en plus à une concaténation de communautés d’intérêts qui au mieux s’ignorent et au pire s’affrontent.
Une prise de conscience des injustices et des inégalités. Plus que les générations précédentes, les jeunes d’aujourd’hui sont conscients que leur chance de réussir socialement et économiquement sont très faibles s’ils portent un nom à consonnance africaine ou maghrébine et/ou vivent à Sarcelles ou à Grigny. Par contre, ils savent que tout devient plus facile lorsque l’on naît à Neuilly sur seine.
Une parole confisquée, pervertie et/ou réprimée. Gilets jaunes, antivax, opposants à la réforme des retraites, aux méga bassines, jeunes en colère, .. Média et politiques main stream appliquent la même ligne de communication : Se saisir du moindre prétexte pour ridiculiser, diaboliser et si cela ne suffit pas à condamner. Une partie de la population en vient à se sentir humiliée. Les associations ne sont pas épargnées (*)
(*) Interdictions de manifestations propalestiniennes en octobre, dissolution de la Coordination contre le racisme et l’islamophobie en novembre, tentative de dissolution du mouvement écologiste « Les Soulèvements de la Terre », menace sur les subventions de la Ligue des droits de l’homme après ses dénonciations des violences policières à Sainte-Soline…
La société dans laquelle nous vivons
Une société qui depuis près d’un siècle privilégie l’individualisme, la réussite personnelle quitte à piétiner l’intérêt général. Cette montée tendancielle des égoïsmes nous insensibilise aux difficultés de l’autre. On préfère détourner le regard.
Des rythmes de vie qui nous aliènent, des existences compulsives qui nous privent du temps de la réflexion. Et pourtant, toujours cette injonction à avoir un avis sur tous les sujets. « Pour ou contre l’immigration », « pour ou contre la peine de mort », « pour ou contre les trottinettes électriques »… La pensée devient binaire. La nuance est devenue suspecte. Stressés, sommés d’avoir une opinion, on finit par tous nous enfermer dans un camp.
Un monde dans lequel on ne se rencontre plus et on ne se parle plus. Disparition de nombreux lieux de socialisation : Commerces et services publics en France rurale, syndicats et partis politiques.
Encapsulés dans nos routines et certitudes, l’étranger au sens large est perçu au mieux comme une silhouette déshumanisée et au pire comme un danger à éliminer. Le policier devient le « sal flic » à éclater et le « jeune bronzé » le sauvage à éliminer.
Des algorithmes et des leaders d’opinion qui nous fracassent les uns contre les autres
Parmi les facteurs technologiques et politiques, on peut citer :
- Les réseaux sociaux qui polarisent et exacerbent les émotions, les affects au détriment de la recherche de vérité et de débats argumentés, constructifs.
- Les jeux vidéo addictifs qui souvent promeuvent la compétition, le combat plutôt que la collaboration et l’entraide.
- Des leaders d’opinion (politiques et magnats de la presse notamment) qui cherchent à instrumentaliser et détourner le malaise social. Ils poursuivent leur agenda réactionnaire et autoritaire.
Les enjeux. Ce qui est en train de se jouer
Dérèglement écologique, guerres et conflits en Ukraine, en Palestine, paupérisation et précarisation, durcissement démocratique et répression des oppositions, …
Face aux menaces qui s’accumulent et se précisent, de plus en plus de citoyens aspirent à une autre marche du monde : écologistes, gilets jaunes, jeunes des ghettos, défenseurs des droits civiques, militants Metoo…
Malheureusement, l’ancien monde résiste à coups d’enfumages, de mépris ou de répressions à ces attentes de changement.
De plus en plus d’individus (et notamment les jeunes) ont ainsi l’impression d’être condamnés à un avenir désespérant (*) pendant qu’une minorité détruit la planète et pillent les biens communs en toute impunité.
(*) une planète bientôt invivable, une promesse de jobs mal payés et déconsidérés, un système politico médiatique qui les ostracisent
Privés de parole et/ou d’écoute, ils assistent à la dégradation de leurs conditions d’existence (climat, droits sociaux, précarisation, ..).
Que faire alors qu’ils sont convaincus -le plus souvent à raison- qu’ils ne seront pas entendus ?
Certains sombrent dans l’anxiété, l’angoisse et le repli sur soi tandis que d’autres choisissent l’action quitte à sortir de la légalité. Certains le font en pleine conscience et d’autre en parfaite inconscience.
Alors au moindre prétexte (violence policière, dispute à l’issu d’un bal, conflit à l’étranger, accident climatique meurtrier ..), la colère et la violence explosent. Toute cette rancœur, toutes ces tensions, il faut que cela sorte !
Pire. Excités par les réseaux sociaux et des leaders de plus en plus clivants, une partie de la population a renoncé à comprendre d’où vient son malaise et difficultés. Il est tellement plus facile de déverser son mal être sur des boucs émissaires : L’arabe, le flic, le maire écolo, le pédé, .. ou le mobilier urbain. Contrairement au château de l’Élysée, ils sont à portée de fourches.
Le taureau lâché dans l’arène et privé d’issue se battra jusqu’à la mort. La violence n’est pas tabou pour celui qui est à bout.
Pour certains des protagonistes, ces pulsions de violence procurent même et enfin la sensation de compter, la jouissance d’exister, de reprendre la main sur son destin l’espace d’une heure ou d’une nuit.
Le cocktail de la mort
Si l’on ne met pas fin à cette société compulsive et manichéenne, nous nous dirigeons tout droit vers le pire : Une montée inexorable de la haine, de la violence et des radicalités au sein de la population. Cette tectonique des foules nous promet deux avenirs mortifères : la fragmentation de la nation ou le durcissement démocratique (l’état policier) avec pour solution finale, l’extermination des dominés et la disparition de la démocratie.
Alors que face à la crise écologique et ses conséquences économiques, sanitaires et démographiques, il est urgent et prioritaire de se faire résilient et donc solidaires.
Agir concrètement à l’échelle locale
Pas d’apaisement sans solution aux motifs de violence.
Rappelons-le. La réponse judiciaire et policière ne peut être considérée comme l’alpha et l’oméga d’une politique de lutte contre toutes les formes de violence.
Car la spirale violences-répression est mortifère autant pour notre démocratie que pour la cohésion sociale.
Les élus locaux qui en appellent à des renforts de police et à plus de fermeté doivent comprendre que la réponse répressive constitue une mal adaptation car :
- Inefficace même si elle s’appuie sur les technologies les plus sophistiquées ; à moins bien sûr d’envisager l’élimination pure et simple des populations désobéissantes
- Mortifère pour la démocratie car qui accepterait de vivre au sein d’une société de la surveillance et de l’emprisonnement systématique de toutes les formes d’oppositions : écologistes, défenseurs de la Palestine, ..
- Coûteux. L’argent investis en forces de l’ordre, caméras de surveillance, logiciels, drones, armement pèsent sur les budgets et l’empreinte carbone de la nation alors qu’il devrait être investi dans la transition écologique et le soutien aux populations fragilisées.
Aussi sans sombrer dans l’angélisme (les fonctions de police et de justice peuvent se révéler utiles dans certaines situations), mettre fin à cette montée des violences suppose de s’attaquer prioritairement à ses causes : pauvreté, discrimination, manque de démocratie, éducation,
Toute solution efficace devrait donc s’appuyer sur trois principes d’action
Changer de regard. Changer de focale
En reconnaissant la pluralité d’une société, on fragmente beaucoup moins. À chercher à ce que tous les habitants de ce pays se ressemblent et adoptent les mêmes comportements sociaux et vestimentaires, nous allons à l’asphyxie sociale. Il s’agit pour chacun d’entre nous de faire preuve de tolérance et d’empathie.
Encore faut-il parvenir à changer le regard des protagonistes. Regard qu’ils posent sur l’autre (le jeune, le bourgeois, le policier, ..) mais aussi sur eux-mêmes.
Ce changement de regard doit être opéré par l’ensemble des parties prenantes à des degrés divers :
- Les élus locaux
- Les forces de l’ordre
- Les révoltés/forcenés (actuels ou potentiels)
- Les habitants d’une manière générale
Il ne sera possible que moyennant un changement d’état d’esprit mais aussi un effort d’information.
Un autre état d’esprit. Qui est le plus violent ? Celui qui brule une poubelle sous l’emprise de la colère ou celui qui à l’année détourne le regard sur la détresse des autres ou choisit d’exploiter des Sans-papiers dans son entreprise ? L’empathie est au cœur de ce changement de regard, de perspective. Lutter contre son propre égoïsme est le principal challenge.
Sortir de ma capsule mentale pour rentrer en résonance avec ce que vivent tous ces « autres » et notamment les plus mal lotis. Comment agirai-je si j’étais à leur place ?
Apprendre à penser contre soi-même. Le doute permet de progresser.
Reprendre le contrôle de nos existences.
Il faut redonner aux citoyens la main sur leur destin. Pour l’élu local, il s’agit de refuser de céder aux sirènes de la répression et au contraire de s’armer de courage pour convaincre ses administrés de la nécessité de se faire confiance et remettre debout au cœur de la cité les habitants réputés à problème.
Proposer une trajectoire porteuse d’avenir et de sens pour le plus grand nombre.
On ne se remet pas debout et commence à marcher que si on est motivé par un but. Pas très motivant de se battre pour faire des études de jardinier pour finalement devoir traverser la rue pour finir à la plonge d’un restaurant. Il s’agit de proposer à l’ensemble des habitants une trajectoire porteuse d’avenir et de sens commun. Quoi de plus motivant que de construire ensemble un monde d’avenir c’est-à-dire résilient selon 4 principes fondamentaux :
- La recherche d’autonomie locale
- La préservation de la planète et des écosystèmes
- La solidarité et l’entraide
- La recherche de bien être pour tous
Conclusion : Il est urgent de mettre fin à cette montée des radicalités et des hystéries. Ce travail d’apaisement et de reconstruction du vivre ensemble doit s’entreprendre dès maintenant en tout cas avant les premières chaleurs (l’été meurtrier).
Good night and good luck

Que faire face à la montée des tensions et de l’autoritarisme dans le monde ?
« L’ère du réchauffement climatique est terminée, place à l’ère de l’ébullition mondiale ». Antonio Gutterez SG de l’ONU. 2023
Crise climatique, crise économique, crises géo politiques mais surtout mais avant tout une crise démocratique !
Nous assistons depuis plusieurs années à un affaiblissement démocratique quasi mondial à l’exception notoire de quelques pays qui tiennent bon à l’instar de la Nouvelle Zélande, de la Suisse et des pays scandinaves. La France quant à elle pointe actuellement à la 23° place de l’indice de démocratie publié par the economist intelligence unit.
L’introduction du dernier rapport donne le ton “The average global index score stagnated in 2022. Despite expectations of a rebound after the lifting of pandemic-related restrictions, the score was almost unchanged, at 5.29 (on a 0-10 scale), compared with 5.28 in 2021. The positive effect of the restoration of individual freedoms was cancelled out by negative developments globally. The scores of more than half of the countries measured by the index either stagnated or declined. Western Europe was a positive outlier, being the only region whose score returned to pre-pandemic levels.”
Rappelons que la démocratie ne se limite pas à voter tous les 4 ou 5 ans entre quelques personnalités cooptées par les médias mainstream.
Entre démocraties imparfaites et vraies dictatures, la distance tend à se réduire !
L’origine du problème. Des politiques qui oublient l’intérêt général
Ayons le courage de le reconnaître, la plupart des régimes -qu’ils s’agissent de démocraties affichées ou de dictatures avérées- sont au service premier du business (officiellement au service de la croissance économique).
Soumis à la pression des lobbies, ils défendent des politiques favorables aux intérêts privés dominants sans état d’âme (rappelons que les industriels allemands complices du régime nazi n’ont pas été beaucoup inquiétés après 1945). Depuis, toujours au nom de ce soi-disant pragmatisme, l’intolérable continue d’être toléré. À titre d’exemples, les Palestiniens et les Ouïghours attendent depuis des années les retombées démocratiques de cette priorité donnée au business.
Pour la majorité des gouvernements et chefs d’état, l’intérêt général et les principes démocratiques ne sont pas l’horizon politique indépassable (la boussole) mais une variable d’ajustement ; la part du pauvre.
Ces politiques pro business s’appuient sur 2 principes : Vendre aux populations le mythe du ruissellement (la mondialisation des échanges entrainera la démocratie et la prospérité universelles) et pratiquer le clientélisme (concéder quelques avantages à certaines catégories de populations peut se révéler payant électoralement parlant).
En période de forte croissance, ces politiques suscitent l’espoir de progrès (pour soi ou ses proches) et donc l’adhésion des peuples. Mais en ce début de crise systémique, alors que le ruissellement est appelé à se tarir, la pression sociale pour plus de justice (économique, sociale, climatique) s’intensifie.
La problématique des chefs d’état orientés « intérêts privés » est donc la suivante : « Comment maintenir le cap de politiques de captation des richesses au profit d’une minorité (*) alors que la demande de justice et de solidarité croit sur fond de crise systémique ? »
(*) En 2020, les 1 % les plus riches possèdent plus de deux fois les richesses de 6,9 milliards de personnes, soit 90% de la population mondiale. Oxfam
L’engrenage fatal.
« Il se passe quelque chose d’étrange dans ce pays et je pense qu’il est temps de nous interroger. Allons-nous laisser l’hystérie collective nous détourner de notre vision des libertés publiques ? ». Eleanor Roosevelt.
Afin de se maintenir au pouvoir quelles que soient les circonstances, nombre de chefs d’état ont déjà choisi d’engager leur pays sur la pente d’un durcissement démocratique dont voici les degrés :
- L’enfumage. « There is no alternative ». Cette célèbre phrase de Margaret Tchatcher illustre à merveille l’effort de mystification pratiqué par les élites économiques et politiques auto pro clamées. Ainsi, il serait impossible et déraisonnable de taxer les super profits mais absolument incontournable et logique d’augmenter la durée des cotisations au régime des retraites ???!! (Malgré les observations du COR et de nombre d’économistes). L’enfumage fait le pari de la crédulité de l’auditoire
- La stigmatisation/disqualification des oppositions. Sur le principe « Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage », toute critique du système en place est ridiculisée voir diabolisée : Populistes, islamo gauchistes, éco terroristes, jeunes racailles, fraudeurs à la sécurité sociale, anti vax égoïstes, syndicats irresponsables, Amish, élus locaux dispendieux, cheminots privilégiés, etc
- Le passage en force et l’affaiblissement des contre-pouvoirs. En France 49.3 à répétition, recours à l’état d’urgence, loi sécurité globale, ..
- La privation/confiscation de libertés. Interdiction de manifester au moindre prétexte, les couvre feux à répétition, les assignations à résidence, les réquisitions de grévistes en l’absence d’état d’urgence, … et bien sûr l’incarcération dans les pays les plus durs
- L’intimidation/la menace. Policiers costumés en robocops, les amendes, les comparutions immédiates, ..
- La surveillance généralisée. Les applications de traçage, les drones, les caméras de surveillance, les écoutes téléphoniques, l’accès aux données privés, ..
- La répression. Tout ou presque a été documenté sur l’augmentation des violences policières, des gardes à vues sans objet, des comparutions immédiates sans suite,..
Pire. L’histoire nous a prouvé que pour se maintenir au pouvoir, les dictateurs n’hésitent pas à détourner la colère légitime de leurs concitoyens vers des cibles expiatoires (les migrants, les arabes, le juif, les homosexuels, etc).
Résultat : De plus en plus de citoyens du monde, se sentent humiliés, méprisés, aliénés dans leur propre pays. Sommés de s’adapter aux conséquences de politiques désastreuses qu’ils n’ont pas décidées. Les manifestations d’opposition -lorsqu’elles sont autorisées- se heurtent à la surdité des gouvernements ou à des promesses sans lendemain… Pour les plus mal lotis, leur pays, leur quartier constitue une prison à ciel ouvert, un ghetto.
A part, sombrer dans la folie, la drogue, le suicide ou la violence quelles options s’offrent à eux ?
La pulsion du forcené : Carburant des dictatures.
Pour justifier leurs détricotages démocratiques, les gouvernements autoritaires ont besoin d’un prétexte. La peur et la haine constituent souvent un excellent carburant.
Concrètement, il s’agit pour ces régimes d’instrumentaliser tout fait divers (attentat, viol, acte d’un déséquilibré, vandalisme, propos déplacés, sifflets, .. ) pour justifier un nouveau recul des libertés quitte à sombrer dans l’absurde (l’interdiction des casseroles :-).
Mieux (ou pire selon le point de vue), une partie de la population saura appréciée cette mise au pas de la « chienlit » et réclamera encore plus de sévérité. La spirale répressive est ainsi enclenchée.
Et pourtant, sachons ne pas tomber dans le piège de la fracture sociale (déjà béante) et de l’hystérie collective qui fait le miel des dictateurs.
Comme peu de pays, la France dispose du potentiel géographique et culturel lui permettant de surmonter cette crise systémique (notamment climatique). Encore lui faut-il résister à la tentation mortifère du repli du soi identitaire et de la guerre intestine.
Être un bon français ne consiste pas à pratiquer un nationalisme rance et égoïste mais à se comporter en citoyen du monde, respectueux et soucieux de valeurs universelles : exemplarité, bienveillance, solidarité, équité … Le chacun pour soi et le chacun contre l’autre seraient fatals pour les nations et la planète.
Le scénario à éviter absolument :
L’affaissement démocratique en cours produit plusieurs phénomènes interdépendants et déjà observables :
- La balkanisation (ou implosion sociale) qui se traduit par un désengagement républicain d’une part de plus en plus importante de la population (montée de l’abstention, développement du communautarisme, du zadisme, ..)
- L’explosion sociale : Multiplication des révoltes (quartiers sensibles, écologistes, gilets jaunes, ..)
- La montée des fondamentalismes -religieux ou non- qui instrumentalisent les peurs et pulsions violentes
- Le tout alimentant un cercle vicieux ; les égoïstes et les psychotés (voir article « La tectonique des foules ») exigeant davantage de fermeté et de répression.
- Enfin, si les tensions internes sont trop fortes et que la répression ne suffit pas, il restera à ces gouvernements irresponsables la solution finale : Déclarer la guerre à un pays tiers ou partir en croisade (ou au djihad) pour détourner l’attention
Il est donc urgent de briser cet engrenage mortifère et de revenir à la promesse de valeur de toute démocratie : L’intérêt général !
Qui peut nous éviter cette promesse de « 1984 » ?
Orwell dans son ouvrage visionnaire « 1984 » décrit une Grande-Bretagne trente ans après une guerre nucléaire entre l’Est et l’Ouest censée avoir eu lieu dans les années 1950 et où s’est instauré un régime totalitaire fortement inspiré à la fois de certains éléments du stalinisme et du nazisme. La liberté d’expression n’existe plus ; tous les comportements sont minutieusement surveillés grâce à des machines appelées télécrans et d’immenses affiches représentant le visage de « Big Brother » sont placardées dans les rues, avec l’inscription « Big Brother vous regarde » (« Big Brother is watching you »).
Nous sommes fin 2023 sur terre : Traçage et surveillance de nos existences sans précédent (*), difficulté croissante à débattre sereinement, diabolisation des oppositions, affaiblissement des contres pouvoirs (justice, agences indépendantes, ..), instrumentalisation des médias et pratique quasi généralisée de la novlangue, hausse des budgets régaliens (armées et police), …
… Le danger totalitaire est de retour dans nombre de pays.
(*) Phénomène facilité et démultiplié par l’armada technologique : logiciels espions, AI, caméras et drones connectés, ..
Alors comment éviter une généralisation des conflits (internes et externes) au prétexte de différences religieuses ou culturelles ? Comment éviter cette promesse d’affrontement manichéen entre les forces du bien et les barbares ?
Comment nous organiser pour trouver une solution à tout ce qui menace notre humanité ?
Qui sera le chevalier blanc d’une humanité en panne ?
L’erreur serait de s’en remettre aux institutions gouvernementales internationales (ONU, Conseil de l’Europe, Union africaine, ..) qui ont jusqu’à présent prouvé leur inaction/incapacité à faire cesser les massacres et les répressions à l’endroit des peuples : Rwanda, Balkans, Ukraine, Palestine, Haut Karabakh.
Rappelons que la Russie est toujours à ce jour membre du conseil de sécurité de l’ONU.
A l’échelle nationale, l’espoir est mince de voir émerger en 2027 un président soucieux de l’intérêt général et de nos valeurs républicaines : Liberté, égalité, fraternité. Un président garant de cette respiration démocratique qui nous fait cruellement défaut.
Car le système politico-médiatico-économique est organisé pour disqualifier toute opposition radicalement démocratique.
Les ONG quant à elles s’acquittent au mieux de leur mission mais refusent pour la plupart de porter un projet politique global susceptible de constituer une alternative. Chacune de ces organisations (Croix rouge, MSF, WWF, Ligue des droits de l’homme, …) prend soin de rester dans son couloir (aide humanitaire, défense des LGBT, des baleines, des arméniens, ..).
Heureusement, il reste l’échelle locale comme bouclier face à la montée des haines et des totalitarismes.
Car les élus locaux pour la plupart d’entre eux sont animés par le désir sincère d’intérêt général. Ils ne sont pas des jouets consentants (élus play mobil) d’intérêts privés ou partisans.
C’est donc à l’échelle locale que cette revitalisation démocratique est le plus immédiatement possible.
Que faire à l’échelle locale ?
Face à l’effondrement systémique qui débute, les élus locaux ne peuvent rester attentistes. Ils doivent prendre l’initiative d’éclairer, mobiliser et rapprocher l’ensemble de leurs habitants pour définir avec eux un horizon local porteur d’avenir et une trajectoire désirable.
Ce cheminement démocratique local s’apparente à un processus de résilience fondé sur 4 principes de développement :
- La solidarité
- Le bien être responsable
- La sobriété
- L’autonomie
Voici les moments forts de ce processus :
- Y viva la fiesta ! Recréer du lien social, de la convivialité. C’est la première étape de tout processus de revitalisation/développement local. Elle s’appuie sur l’organisation d’un ou plusieurs évènements ludiques permettant de mobiliser progressivement la plus grande partie de la population
- Lumières d’Alexandrie. Éclairer, informer, éduquer, démasquer les fakes news : Il s’agit de proposer des tables rondes, des rencontres, des débats, des campagnes d’information permettant aux habitants d’apprendre à s’informer, à appréhender objectivement les évènements et à débattre constructivement
- Le combat des dieux. Définir collectivement (avec l’ensemble des habitants) les valeurs qui constitueront la charte (le blason) de la communauté locale
- Agorapolis. Organiser les conditions d’une réelle respiration démocratique. Susciter le désir de citoyenneté active (implication et participation)
(La palestine)… On l’observe, on la scrute, on l’encourage ou on lui fait la leçon, mais c’est elle qui nous regarde depuis l’avenir de notre humanité. La Palestine vit déjà à l’heure d’un monde aliéné, surveillé, encagé, ensauvagé, néolibéralisé. Les Palestiniens savent ce que c’est d’être un exilé sur sa propre terre. Apprenons d’eux ! ». Christophe Ayad
Good night and good luck

De plus en plus de français (et d’étrangers d’ici et d’ailleurs) souffrent de la pauvreté ou s’en approchent dangereusement (étudiants, travailleurs pauvres, solos ubérisés, chômeurs, « bénéficiaires » du RSA).
L’enjeu est de taille car le désespoir mène inexorablement au pire (révoltes, émeutes, violences, vote de la haine). Face à ce risque d’explosion sociale, la plupart des politiques trahissent actuellement des inquiétudes et s’intéressent enfin à la question de la pauvreté et du pouvoir d’achat.
Car ne l’oublions pas. La pauvreté est le cancer de la cohésion sociale alors que les nations et leurs territoires de proximité doivent pouvoir compter sur l’effort de tous pour affronter les défis actuels et à venir (notamment climatique).
Définition et dimensionnement du concept.
Définition : Il n’existe pas de définition totalement consensuelle mais on peut avancer sans prendre beaucoup de risques qu’Être pauvre, c’est ne pas disposer des moyens nécessaires à une qualité de vie jugée minimale.
Selon l’Insee, en 2019 la France métropolitaine comptait 9,2 millions de pauvres, c’est-à-dire qui vivent avec moins de 1 100 euros par mois pour une personne seule et 2 310 euros pour un couple avec deux enfants. Ce qui représentait 14,6 % de la population.
Le concept de pauvreté comporte aux moins 2 dimensions : Une dimension objective (économique) et une dimension psychologique ou ressentie (se sentir exclu de la société, assisté, inutile, trop fragile pour tenir debout tout seul, ..)
Toute solution au problème de la pauvreté se doit donc d’adresser ces 2 dimensions.
Lutter contre pauvreté objective consiste ainsi à redonner du pouvoir d’achat et remédier à la pauvreté ressentie suppose de sortir de l’exclusion et de l’assistanat ceux qui doivent retrouver une place d’Acteur dans la société (pour peut-être un jour, retourner voter).
La problématique est donc la suivante : Comment redonner du pouvoir d’achat sans tomber dans le piège de l’assistanat ?
Mais au fait, redonner du pouvoir d’achat pour satisfaire quels besoins ?
Cliniquement, il s’agit de permettre aux individus de satisfaire quelques besoins essentiels :
- Se nourrir
- Se loger
- S’habiller
- S’équiper
- Se soigner
- ..
Que peut faire une collectivité locale en matière de lutte contre la pauvreté sans attendre un changement radical de politique à l’échelle nationale ou européenne ?
La solution mécanique et possiblement futuriste serait de verser un revenu à tout (revenu universel) ou partie (revenu de subsistance pour les plus démunis) des habitants. Mais, en l’état actuel du rapport des forces économiques, la mise en place d’un revenu universel local semble impraticable.
En revanche, voici 3 axes de solutions à la portée des collectivités locales mais qu’à ce jour, elles ne pratiquent pas suffisamment :
- Booster la création d’activités/emplois de proximité utiles à la communauté et justement rémunérés
- Faciliter l’échange et la mutualisation de biens et de services au sein de la communauté locale
- Encourager la sobriété et la consommation éclairée
Détaillons les solutions correspondant à ces 3 axes de travail :
1°) Faciliter la création d’activités/emplois de proximité utiles à la communauté
Voici les étapes du processus qui pourrait être piloté par les collectivités locales :
- Mobiliser la population (via son conseil citoyen et l’ensemble des acteurs locaux) pour recenser/définir les activités/services manquants (carte des vulnérabilités locales)
- Hiérarchiser ces activités/services en fonction de leur contribution à l’intérêt général et leur effet multiplicateur (en termes d’emplois et de création de richesses)
- Proposer aux habitants d’exercer ces activités ou d’occuper ces emplois (à temps plein ou partiel)
- Pour rémunérer ces contributions, combiner plusieurs dispositifs :
- Apporter un soutien financier (caution solidaire, subventions) dans le cas de création d’activités (entreprises, commerces ou associations)
- Mobiliser du financement participatif en faisant appel au habitants actuels ou à la diaspora (anciens habitants, familles, ..)
- Déployer une monnaie locale (en intercommunalités si possible) afin de s’assurer que la création de richesses contribuera complètement au développement local
- Prendre en charge une partie des salaires (en euros mais aussi en monnaie locale)
2°) Faciliter l’échange et la mutualisation de biens et de services au sein de la communauté
- Mettre en place une plateforme d’échange de services et de mutualisation
- Ouvrir une centrale d’achat qui permettrait des achats groupés (d’énergie, de fournitures, … ) avantageux au bénéfice des habitants.
- Faire appel aux dons d’entreprises ; invitées à faire des dons en nature à la centrale d’achat ou à lui ouvrir une ligne de crédit
Principes de fonctionnement de la plateforme d’échange et de mutualisation
- Tous les habitants sont invités à indiquer sur la plateforme la ou les compétences qu’ils sont disposés à mettre à la disposition des autres utilisateurs ; le ou les biens qu’ils sont prêts à prêter, donner, partager.
- En contrepartie de quoi, soit ils optent pour un échange simultané de service (ex : « j’échange une heure de cours de français contre une table de cuisine) soit ils reçoivent un certain nombre de points qui leur permettent d’acquérir quand ils le souhaitent un bien ou un service proposé sur la plateforme. Dans ce cas, il s’agit d’un échange non simultané.
- La plateforme Home exchange (appliqué à l’échange de logements) constitue une bonne source d’inspiration
3°) Encourager la sobriété et la consommation éclairées
Il est troublant de constater que de nombreuses personnes peuvent à la fois se retrouver dans l’impossibilité de payer leur facture d’électricité et en même temps cumuler 2 ou 3 abonnements téléphoniques.
Ceux qui ont déjà participé à des commissions de surendettement organisées par la Banque de France peuvent en témoigner.
Ces exemples loin d’être isolés démontrent la nécessité de prendre du recul par rapport à nos pratiques de consommation car nous ne sommes pas tous égaux face au matraquage publicitaire. Certains résistent à l’injonction « consomme pour exister » et d’autres pas.
Il s’agit donc -en s’appuyant notamment sur le tissu associatif et des actions de communication- d’amener les habitants (et pas que les pauvres) à prendre du recul par rapport à leurs pratiques de consommation. De toute façon, la lutte contre le réchauffement climatique nous imposera de faire preuve de plus de sobriété.
Les bénéfices attendus des 3 axes de solutions que nous proposons :
- Développement de la résilience locale (renforcement de l’autonomie et de la solidarité)
- Sortie de la pauvreté objective et ressentie d’une partie de la population
- Amélioration de la qualité de vie en boostant la création d’activité utiles au plus grand nombre
- Émancipation des habitants de l’injonction (« consomme pour exister »)
Pour conclure et compléter, insistons sur la nécessité de mettre en place une politique de formation locale permettant de mettre en adéquation les besoins d’emplois/activités utiles et les compétences des habitants.
Good night and good luck
Prendre sa part de responsabilité dans la lutte contre le réchauffement climatique et le risque de pénurie (en cas de nouvelle pandémie ou de conflits géo politiques consiste pour les collectivités et leurs entreprises locales à s’assurer que leurs projets d’aménagement au sens large contribuent à la résilience du territoire. Rappelons qu’un projet résilient se caractérise par :
- Une empreinte carbone minimale (sur l’ensemble de son cycle de vie)
- Résiste aux évolutions et accidents climatiques
- Utilise au maximum les ressources locales pour réduire la dépendance (ou vulnérabilité) du territoire (et son empreinte carbone)
- Le projet est porté et supporté par les parties prenantes
- Au service de l’intérêt général (*) en tout cas du plus grand nombre d’habitants, de la communauté locale
(*) Contribution d’un projet à l’intérêt général
- Préserve la planète et le vivant (pollution, bio diversité, empreinte carbone)
- Améliore la qualité de vie du plus grand nombre (dont les plus fragilisés)
- Répond à un besoin essentiel (se nourrir, se loger, se soigner, ..)
La décision de lancer, de poursuivre, d’abandonner ou de modifier un projet est normalement prise dans le cadre d’une réunion de revue de projets. Pour les projets en cours (déjà engagés), il s’agit d’évaluer :
- Leur contribution à l’intérêt général
- Leur coût budgétaire
- Leur valeur contributive (la réalisation de ce projet conditionne la réalisation d’autres projets
- Leur empreinte carbone et le niveau de risque qui leur est associés (risques sociaux, techniques, climatiques, ..
En fonction de ces éléments, décider des projets qui doivent être abandonnés ou modifiés (projets trop avancés pour être abandonnés mais qui devraient être plus résilients Avant de décider de lancer un nouveau projet, il s’agit évaluer :
- Sa contribution à l’intérêt général
- Son coût budgétaire
- Sa valeur contributive (la réalisation de ce projet conditionne la réalisation d’autres projets
En fonction de ces 3 éléments, décider de l’opportunité de lancer (ou d’accpeter) le projet Si le portefeuille de projets à passer en revue est celui d’une entreprise, il revient le plus souvent au comité de direction de décider de ces arbitrages Dans le cas du portefeuille de projets d’une collectivité locale, 2 possibilités :
- La revue de projets est effectuée par un Comité de gouvernance (élus et grands décideurs) aidé par des sachants/experts. Posture adoptée par les élus : Programmateurs de leurs territoires
- La revue de projets est réalisée par un Conseil citoyen consultatif avec l’aide des sachants/experts. Posture adoptée par les élus : Coachs de leurs éco systèmes
 Créon – Un monde d'avenir
Créon – Un monde d'avenir